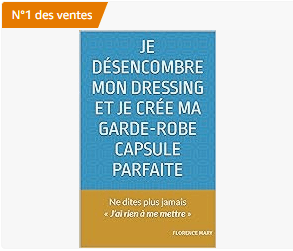Dernière mise à jour le 1 avril 2025
Ce matin je découpais des prunes du jardin pour en faire une tarte, quand je me suis demandé si je pouvais refaire pousser des pruniers avec les noyaux. Une rapide recherche sur Internet m’a appris que oui. Puis j’ai commencé à réfléchir au fait que ça n’allait peut-être pas sortir de terre et que j’aurais fait ça pour rien, ou encore à ce que j’allais faire avec mes pruniers une fois sortis de terre (« Je vais pouvoir les échanger contre des boutures d’autres plantes »).
Là, j’ai été frappée par cette question : Pourquoi je n’arrive plus à faire des choses juste par curiosité ou pour le plaisir, sans me focaliser dès le début sur l’utilité et la finalité de l’activité.
La Hustle Culture des années 2000
Si tu étais jeune adulte dans les années 2000 à 2010, tu as peut-être, comme moi, été grandement influencé·e par ce qu’on appelle la « hustle culture« , que l’on pourrait traduire par la culture de l’hyperproductivité ou de surperformance (et avec un oeil critique aujourd’hui, culture du burnout ou de la productivité toxique…).
La culture de la surperformance est née dans les années 1990 et 2000 suite au boom entrepreneurial, et a été glamourisée et popularisée par les blogs et les chaînes Youtube, et plus récemment par des réseaux sociaux comme Instagram, Tik Tok, LinkedIn…
Chaque moment doit être utilisé de manière productive pour s’assurer la réussite et le succès, aux dépens du bien-être et de la détente.
Tout peut être productif et rentable
Pour moi, cette influence s’est surtout marquée par l’impression que chaque hobby doit pouvoir être rentabilisé, sinon à quoi bon ? C’était la tendance du « side hustle« , le petit job « à côté » du travail principal (et qui peut s’accumuler à l’infini).
Au cours de la première décennie 2000, le message sur les réseaux sociaux et les blogs/vlogs était clair : si tu es bon·ne à quelques chose, tu devrais le monétiser ! Selon l’idée qu’en travaillant dans un domaine qui nous passionne, on ne travaille jamais vraiment, tout loisir créatif que l’on affectionne pourrait devenir notre nouvelle source de revenu.
A l’époque, j’ai totalement mordu à l’hameçon de cette nouvelle tendance. Pourquoi se contenter de donner entre 35 et 40 heures de son temps à un employeur chaque semaine, quand on pouvait en plus rentabiliser ses soirées et ses weekends pour gagner plus d’argent ? Pourquoi se contenter de dessiner, broder, coudre, danser, écrire, cuisiner… juste pour soi, si on peut produire des choses ou du contenu et gagner de l’argent en échange ?
Choisis un hobby comme travail, et tu n’auras plus jamais de hobby
Si l’idée semble alléchante, dans les faits, j’ai découvert une réalité dont on parle trop peu : professionnaliser son hobby, ça veut aussi parfois dire abandonner son hobby. Quand un loisir devient une source de revenus, mais également de stress, de négociations, de logistique, d’administratif, de taxes… c’est très facile de ne plus voir cette activité comme un loisir et de ne plus en ressentir les bienfaits.
Hop, ce passe-temps qui te permettait de t’évader devient synonyme de contraintes, de niveau de productivité à assurer, de problèmes à gérer, sans parler du temps que cela te prend.
Certes, certaines personnes y ont trouvé leur voie et en vivent, mais pour beaucoup d’autres, c’est juste une pression supplémentaire dont on se passerait bien. C’est pour cette raison qu’à mes yeux le freelancing et l’auto-entrepreneuriat ne sont pas des solutions miracles quand on ne se sent pas bien au boulot.
Le droit d’être mauvais·e dans ses passe-temps
J’ai remarqué qu’un autre effet pervers de cette culture du « tout-rentabilisé », c’est que tout loisir devient compétitif, qu’il faut absolument « performer » et obtenir des résultats.
Ou comment ouvrir la porte à l’éternelle insatisfaction. On passe déjà des entretiens annuels pour savoir comment on est coté au travail (ou aux études, a.k.a les examens), est-ce qu’on ne devrait pas se foutre un peu la paix en dehors des heures de travail et penser à son plaisir ?
J’ai eu une révélation il y a quelques mois en lisant quelqu’un s’exprimer sur le fait qu’il n’est pas nécessaire d’être bon à ses hobbies. J’avais perdu ça de vue ces 15 dernières années : en fait, un passe-temps, ça sert à prendre du bon temps, et ce plaisir, cette relaxation, ne devraient pas dépendre des résultats.
Evidemment, comme presque tout un chacun, je suis motivée par l’envie d’apprendre et d’évoluer, et j’aime quand une de mes broderies est jolie, quand je fais un dessin particulièrement bon par rapport à mon niveau moyen… mais je me répète régulièrement ce mantra pour accepter de faire les choses à mon rythme, sans chercher absolument un résultat ni avoir un projet derrière la tête :
Être mauvais·e à quelque chose est le seul moyen de devenir bon·ne… et c’est ok de ne jamais devenir bon·ne dans ses hobbies !
Garder une ancre en dehors de sa vie professionnelle (et des tracas du quotidien)
Ces derniers temps, j’avais l’impression d’avoir perdu le goût de toute chose, plus rien ne me donnait envie en dehors du travail, plus aucune activité de loisir ne me motivait. Réaliser que j’ai été baignée dans cette hustle culture aussi longtemps et ce que ça avait changé en moi m’a aidée à faire marche arrière.
J’ai réalisé entre autres que ne pas avoir de hobby pour lequel on ne doit rendre de compte à personne m’enlevait cette ancre qui permet de garder pied quand les choses se passent moins bien au travail, ou même dans d’autres domaines privés.
Cet article, c’est mon encouragement à conserver ces moments de détente insouciants, qui t’appartiennent, que tu peux faire évoluer à ton rythme, et où la recherche du résultat n’est pas la motivation première. Pour ton bien-être.